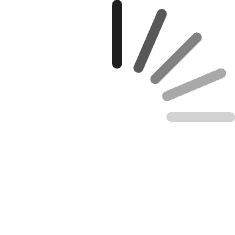Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Ardennes
Ariège
Aude
Aveyron
Bas-Rhin
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Côte-d'Or
Côtes d’Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Essonne
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Gironde
Haute-Garonne
Haute-Loire
Haute-Saône
Hautes-Pyrénées
Haute-Vienne
Hauts-de-Seine
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Landes
Loire-Atlantique
Loir-et-Cher
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Mayenne
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Paris - Notre-Dame
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Rhône
Saône-et-Loire
Sarthe
Tarn
Tarn-et-Garonne
Val d'Oise
Vaucluse
Vendée
Vienne
Yonne
Yvelines
Actualité de la base Muséfrem
Vous avez dit prosopographie ?
Histoire de l'enquête Muséfrem
Les fondements de l'enquête Muséfrem
Les contributeurs depuis 2003
Les partenaires scientifiques
Contact
Pour citer Muséfrem
Musique et musiciens d’Église dans le département de l'ARIÈGE autour de 1790
Loin de Paris, l’Ariège est un petit territoire essentiellement montagnard. Toutefois ni la situation excentrée ni un relief accidenté n’expliquent les maigres effectifs musicaux documentés à la fin de l’Ancien Régime : il faut plutôt incriminer l’incendie des archives qui en 1803 a détruit une part importante de la documentation, notamment celle des débuts de la Révolution où devaient sans doute se trouver les dossiers de carrière des musiciens des églises et abbayes. L’enquête a malgré tout fait surgir des vestiges de la plupart des corps de musique du territoire et permis d’esquisser d’intéressantes silhouettes de musiciens.
I - UN TERRITOIRE DE MONTAGNE À L'ORGANISATION COMPLEXE
• • • Un espace pyrénéen
L’Ariège est un petit département de 4 800 km2 situé dans le sud-ouest pyrénéen. Il est entouré, à l’est, par les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales et à l’ouest, par la Haute-Garonne. Sa frontière avec l’Espagne et la principauté d’Andorre est une véritable barrière dont les sommets culminent au-dessus de 2500 mètres, 3142 au pic d’Estats. C’est là, à la limite des Pyrénées orientales et du Pas de la Case que la rivière qui lui a donné son nom prend sa source. Elle traverse le département du sud jusqu’au nord et conflue avec la Garonne en amont de Toulouse. Ses affluents, ainsi que ceux du Salat qui court rejoindre la Garonne vers l’ouest, compartimentent les hautes terres du sud en vallées où se nichent des églises romanes. Puis, l’altitude des chaînes s’abaisse peu à peu. Les flancs toujours à pic et taillés dans les roches tendres conservent des grottes, abris millénaires de peuples préhistoriques. De petites villes au riche passé y sont nées, comme Ax-les-Thermes, Tarascon, Saint-Girons, ou Foix qui annonce l’approche des basses altitudes et d’où s’élancent de manière grandiose les trois tours du château comtal. Alors, l’Ariège traverse le piémont, s’apaise avant d’atteindre Pamiers, comme l’Hers à Mirepoix, et comme les rivières garonnaises de l’ouest. Le relief glisse vers un paysage de plaines et de collines où s’égrène tout un réseau de petites villes, telles Varilhes, Saverdun, Lézat-sur-Lèze, Mazères. Alors, nous entrons très vite dans la plaine toulousaine. Le département, c’est indéniable, est d’abord un pays de montagne.
• • • Un département issu de divisions administratives et religieuses compliquées
Situé aux confins des très anciennes provinces historiques du Languedoc et de la Gascogne, le nouveau département naît officiellement le 4 mars 1790 sous l’orthographe d’Arriège. Mais sa gestation fut difficile et les députés des provinces voisines exprimaient leur intention de se partager le comté de Foix qui n’était pas assez étendu pour constituer un département. Le résultat fut tout autre puisque ce même comté de Foix, avec cette ville comme chef-lieu, en constitue la base. Trois districts, ceux de Mirepoix, de Saint-Girons et de Tarascon sont aussitôt créés.
Sur le plan ecclésiastique, l’héritage n’était pas simple non plus, comme l’exprime Claudine Pailhès dans l’Inventaire sommaire de la série G des Archives départementales :
« La géographie ecclésiastique des pays d’Ariège est fort complexe. Les localités qui en 1790 formèrent le département appartenaient en effet à six diocèses suffragants de trois métropoles : il s’agissait, à l’ouest du diocèse de Couserans dans sa quasi-totalité, et de la paroisse de Betchat du diocèse de Comminges, suffragants tous deux du siège d’Auch ; au centre, du diocèse de Pamiers et d’une grande partie des diocèses de Rieux et de Mirepoix, tous trois suffragants du siège de Toulouse ; à l’est enfin, des paroisses du Donnezan, dépendant du diocèse d’Alet suffragant du siège de Narbonne. »
Il s’agissait de petits diocèses. Bien que les chiffres fluctuent selon les sources, le nombre de leurs paroisses atteignait à peine la centaine. Par exemple, d’après l’abbé Cau-Durban, au début de son travail sur le clergé du Couserans, ce diocèse ne comprenait en 1789 que 77 paroisses, 21 annexes et 21 vicariats. En revanche, leurs populations présentaient des caractères culturels différents, y compris entre les évêchés de Pamiers et de Mirepoix, l’espace mirapicien conservant des liens avec Carcassonne et Narbonne. Néanmoins, c’était le diocèse de Couserans qui affirmait l’identité la plus originale. D’abord, Haute-Ariège de l’ancien diocèse de Pamiers de culture languedocienne et Couserans de culture gasconne se tournaient le dos : les vallées du premier coulent vers la rivière Ariège et celles du second regardent vers l’ouest, en direction de la Garonne. Mais surtout, l’existence de ce diocèse, comme son voisin le Comminges, remontait au cinquième siècle alors que les autres étaient des créations des années 1295-1317 obtenues, après l’écrasement cathare, par la division du vaste et riche diocèse de Toulouse, et de l’archevêché de Narbonne pour celui d’Alet. Enfin, le Couserans avait mieux résisté à la propagation du protestantisme. Or, ce territoire, dont Saint-Lizier était le siège, représente environ un tiers du département, ce qui n’est pas négligeable.
Cependant, dans le comté du Couserans comme dans le comté de Foix, beaucoup de vallées et d’agglomérations de toutes dimensions s’étaient vu octroyer des chartes de liberté par les seigneurs du Moyen Âge. Même si la monarchie absolue avait grignoté certains droits, ce système d’organisation a subsisté jusqu’à la Révolution, ce qui est un trait d’union fondamental. Et les registres des délibérations de ces Conseils de ville sont des sources précieuses pour les chercheurs.
• • • Montagne et Plaine offrent des ressources complémentaires
Les conditions naturelles de l’espace ariégeois ont déterminé des cadres de vie très contrastés. Seul, le quart le plus septentrional échappe à la montagne. À l’opposé, le sud, notamment le Couserans surnommé le « pays aux dix-huit vallées », est entaillé de nombreuses vallées surpeuplées et marqué par des hivers enneigés. Les pentes portent des forêts ainsi que de beaux pâturages qui fournissent les matières premières de l’artisanat. En revanche, les terres labourables, peu fertiles et de trop faible superficie, peinent à assurer l’autosuffisance alimentaire, et le moindre aléa climatique peut être redoutable. Elles portent des céréales pauvres comme le seigle et l’orge, du millet, une grande variété de légumes secs, et plus tard, les pommes de terre à propos desquelles Stéphane Lafuente (voir bibliographie) rapporte qu’en 1792, dans le district de Tarascon, elles « servent de nourriture aux trois quarts des habitants pendant huit mois de l’année ».
Par chance, le sous-sol de la montagne dispose de ressources minières pourvoyeuses d’emplois. Le minerai de fer est roi. Il abonde partout, jusqu’aux gisements de Montferrier, village pourtant excentré au-dessus de Lavelanet. Soutenu par l’abondance des forêts productrices de charbon de bois, il est à l’origine de forges et d’une métallurgie disséminée. Ainsi, les forgeurs de Foix et de ses environs utilisent le fer des mines du Rancié situées dans la montagne qui domine la vallée de Vicdessos, à la latitude de Tarascon. Dans chaque vallée, les villages et hameaux sont rapprochés par des liens d’organisation que les chartes seigneuriales respectent. Ainsi, comme l’explique Claudine Pailhès au début de son ouvrage intitulé La vie en Ariège au XIXe siècle, ce sont les droits d’usage très larges détenus dans les forêts ainsi que l’extraction des richesses du sous-sol qui ont permis aux habitants de survivre. Et la gestion communautaire reflète une certaine autonomie au sein de paroisses très étendues. Bien souvent, une seule des petites agglomérations de la vallée s’est un peu urbanisée grâce à l’accueil des administrations et des divers services, sans oublier les soins apportés à son église. Ainsi s’explique l’existence surprenante de lieux de musique isolés, voire parfois la présence d’un orgue, comme dans l’église paroissiale de Vicdessos.
Le massif le plus septentrional, le Planturel, oscille surtout entre 400 et 800 mètres d’altitude. Telle une bande orientée nord-ouest / sud-est qui englobe Foix en son milieu, il procure une voie de passage majeure car il traverse entièrement le département. Ainsi, une ligne de villes court depuis Le Mas-d’Azil jusqu’à Lavelanet et Mirepoix. À l’est, le Pays d’Olmes et les villages montagnards des environs allient l’intense activité textile et le travail intensif de la petite métallurgie produisant des milliers de clous qui alimentent les marchés locaux et le négoce extérieur. Tout est bon pour l’artisanat. Même les racines du buis qui, à l’instar des cornes des animaux d’élevage, servent de matière première à la fabrication massive des peignes découpés à la main.
En descendant vers Pamiers, commencent les collines et les plaines du nord beaucoup plus propices à l’agriculture. Les métairies, propriété des clercs et de la bourgeoisie des gros bourgs, et des gens du présidial pour Pamiers, dominent tout un monde de brassiers et de travailleurs de la terre. C’est le domaine du froment et du « gros millet », surnom local du maïs, qui améliore le système persistant de l’assolement avec jachère. Les troupeaux de moutons procurent la matière première aux métiers du textile partout présents, sans oublier les carrés de chanvre et de lin sur les meilleurs endroits. Au nord-est, le Lauragais ariégeois ne produit plus beaucoup de pastel depuis l’arrivée de l’indigo d’outre-mer. En revanche, les collines au sol très riche sont de véritables greniers à céréales et elles produisent aussi beaucoup de plantes textiles, chanvre et lin.
• • • Des faiblesses persistantes
Le nouveau département de l’Ariège n’est donc pas dépourvu d’atouts naturels. Mais il souffre de grandes faiblesses. Il se trouve à l’écart du « canal royal du Languedoc » (ou canal du midi), c’est-à-dire de l’axe commercial Toulouse-Méditerranée. À l’intérieur, la circulation des marchandises demeure très réduite entre la montagne et la plaine. Un numéro des Nouvelles Ecclésiastiques publie en 1781 un véritable réquisitoire contre l’évêque de Pamiers qui occupe le siège depuis quarante ans et qui aurait détourné tous les moyens disponibles à l’entretien de son diocèse. Ainsi, « plus de deux millions ont été imposés pour les chemins, et il n’y en a pas un qui soit praticable ».
Le vieux prélat est également attaqué sur sa mauvaise gestion de l’instruction : « une bibliothèque publique, ressource inappréciable pour un pays où les moyens d’étudier sont encore plus rares que le goût de l’étude a été scandaleusement dilapidée ». Nous touchons là au gros retard de l’éducation. Il n’existe qu’un seul véritable collège pour l’ensemble du comté de Foix, celui de Pamiers. Encore a-t-il beaucoup perdu de son efficacité depuis le départ des Jésuites. Les petites écoles semblent peu fréquentes dans les paroisses rurales. Ainsi, Louis Blazy (voir bibliographie) présente-t-il une étude réalisée sur les seize paroisses du diocèse de Rieux qui constituent, sous la Révolution, le canton ariégeois du Mas d’Azil : « Sur seize paroisses, six seulement possédaient une école de garçons avant la Révolution (…) et il n’y avait que trois écoles pour les filles ». Et il faut rappeler que, dans les vallées surpeuplées de montagne, une seule agglomération, celle qui détient l’église paroissiale, s’est dotée d’une petite école avec régent, ce qui exclut, de fait, les enfants des succursales et hameaux éloignés. Ainsi, misère et illettrisme caractérisent une partie importante de la population. Et ce n’est qu’en 1750 qu’un Toulousain, Jean-Florent Baour, vient créer à Pamiers la première imprimerie. Pourtant, à Saint-Girons, les eaux du Salat contribuaient depuis longtemps à une production papetière importante et renommée.
Beaucoup de sources de l’histoire ariégeoise font défaut. Il faut bien entendu rappeler la cause majeure et avérée : cet incendie de 1803 qui a causé des dommages énormes aux archives départementales installées à l’Hôtel du département de Foix, c’est-à-dire dans les bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye Saint-Volusien. De plus, les registres des délibérations capitulaires conservés s’arrêtent bien avant 1790. Le diocèse de Couserans est le plus durement frappé par la pénurie d’archives. Or, les registres paroissiaux présentent également des périodes lacunaires, comme pour la ville de Saint-Girons dont les actes conservés ne commencent véritablement qu’à la fin de la Révolution, ou bien pour celle de Rimont qui porte l’abbaye de Combelongue totalement absente des activités musicales connues au XVIIIe siècle.
II - PAMIERS, SIÈGE D'ÉVÊCHÉ ET PREMIÈRE VILLE DU DÉPARTEMENT
Pamiers est le siège de l’évêché depuis sa création en 1295. Michel Detraz (voir bibliographie) a résumé comment le pape Boniface VIII justifia son choix : « Il n’y a pas dans la contrée de lieu plus “insigne”, plus “noble”, plus “commode” ». Autrement dit, Pamiers était la ville la plus apte et la mieux localisée pour ramener vers l’Église catholique des populations dites hérétiques. Aussi, l’abbatiale Saint-Antonin fut-elle élevée au rang de cathédrale tandis que Bernard Saisset, son abbé, devenait le premier évêque. Après un premier remaniement en 1308, les limites furent arrêtées définitivement en 1318, garantissant un revenu annuel très modeste de 11 600 livres.
• • • En 1790, Pamiers domine le département. Bien que seulement peuplée d’environ 5 000 habitants, sa position géographique lui assure un avantage fondamental. Déjà sortie de la montagne, « c’est une ville de vallée et une ville de piémont », selon la formule de Michel Sébastien (voir bibliographie). Elle est également tournée vers la plaine et n’est distante de Toulouse que d’une soixantaine de kilomètres. D’autre part, elle est le siège de la sénéchaussée et du présidial du comté de Foix, ainsi que celui de la maîtrise des eaux et forêts. Son évêque préside la réunion annuelle des États du comté. Aussi, la désignation de Foix comme chef-lieu apparaît-elle alors comme une injustice pour les notables comme pour la population appaméenne, d’autant plus que l’alternance prévue avec Foix ne fonctionne pas et que leur ville n’est même pas chef-lieu de district, tout au moins dans les premières années.
Longeant la rivière Ariège, Pamiers est née, comme l’exprime François Taillefer (voir bibliographie), sur « le bord de la terrasse qui domine le fond de la vallée », protégée par la butte du Castela où se dressa ensuite la forteresse des comtes de Foix. Ce fut seulement au XVIe siècle que l’église du Mercadal accéda peu à peu à la dignité de cathédrale, supplantant l’ancienne abbatiale située en dehors des murs. Ici, commence la ville haute de la paroisse du Mercadal, avec la cathédrale, le palais de l’évêché, le collège, le séminaire, le présidial, le monastère du Carmel. Plus au nord, dans la partie basse, se tient l’église collégiale et paroissiale de Notre-Dame-du-Camp, bâtie au XIIe siècle, en dehors des premières fortifications, c’est-à-dire hors des murs comme son nom l’évoque. Cette seconde paroisse, vaste, où le nombre de naissances annuelles dépasse largement celui de la paroisse cathédrale, abrite une population nombreuse. Les canaux, issus des bras dérivés de la rivière, enserrent ce que nous appelons de nos jours « la ville historique ». Cette eau remplit une fonction économique importante puisqu’elle fait tourner de nombreux moulins et qu’elle subvient aux besoins en eau des teintureries et des tanneries. Les enclos des communautés religieuses abondent. Les Augustins, les Jacobins, les Carmes et les Cordeliers, implantés au Moyen Âge, ont résisté, en dépit de leurs faibles effectifs, aux suppressions qui frappaient les maisons sous-peuplées, tout au contraire des Clarisses encore nombreuses qui ont été contraintes d’abandonner leur maison. Les créations post-tridentines sont bien représentées : vingt Carmélites, vingt-sept enseignantes ursulines, quatre filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul à l’hôpital depuis 1772 et les Lazaristes qui dirigent le séminaire. Quant au collège, pourtant le seul du diocèse, rappelons qu’il périclite depuis le départ forcé des Jésuites.
Bien que les habitants aisés de la moitié septentrionale du comté de Foix y trouvent tout ce qui fait leur qualité de vie, la première ville du territoire conserve un caractère rural très prononcé. Pour Michel Detraz, l’agriculture y rassemble la première catégorie socio-professionnelle en nombre, et « il faut sans cesse des arrêtés de police pour interdire de laisser les cochons divaguer dans les rues, pour s’opposer à ce qu’on entrepose le fumier devant les maisons… ». Dans son très critique Journal de Voyages de l’été 1787 dans le Languedoc, Arthur Young admire d’abord cette ville entourée par « beaucoup de vignes » et « qui est située dans une superbe vallée, au bord d’une belle rivière ». Mais il découvre ensuite « que la ville elle-même est laide, puante et mal bâtie ». En revanche, pour l’abbé Expilly dans le Grand Dictionnaire géographique, historique et politique, paru en 1764, c’est alors une « jolie ville », « dont l’enceinte est assez grande et les rues bien percées ». Certes, les églises sont en bon état. Pourtant, Michel Detraz est catégorique : lors de la paix d’Alès de 1629, les guerres civiles « laissaient une ville ruinée, couverte de cendres et de gravats, une population exsangue, décimée par les combats et les maladies, une économie totalement perturbée, un énorme endettement de la ville, du clergé, de certains particuliers ». Seuls les clochers avaient été épargnés en raison de leur caractère défensif. Ainsi, d’après Isabelle Rebay-Clottes (voir bibliographie), quand l’évêque Henri de Sponde entra d’exil, « il dut célébrer la messe dans le temple protestant bâti en 1577 ». Par conséquent, les reconstructions sont demeurées intensives pendant tout le règne de Louis XIV. Le nouveau palais épiscopal, de nos jours l’hôtel de ville, est achevé au début du XVIIIe siècle. Mais il subsiste des difficultés qui affleurent de temps en temps. Ainsi, en 1757, le curé et le chapitre de Notre-Dame-du-Camp se trouvent obligés d’aller célébrer les offices canoniaux et paroissiaux dans l’église des Cordeliers « par suite de l’état déplorable de la toiture » de leur église, explique Eugène Ferran (voir bibliographie). En fait, il faut attendre la décennie 1770 pour que les grands travaux civils et religieux touchent à leur fin. C’est alors que le nouveau palais du présidial est terminé, ainsi que la chapelle du Carmel, austère à l’extérieur et d’un baroque particulièrement soigné dans son intérieur. La cathédrale Saint-Antonin ne garde actuellement de son passé que très peu d’éléments architecturaux extérieurs : l’archivolte du portail roman aux chapiteaux historiés et l’admirable tour à base octogonale gothique du clocher briquetée avec une grande finesse. Pour la reconstruction, Louis XIII avait donné les matériaux issus de la destruction du château. On demeura fidèle au style languedocien de la nef unique et large. Le chantier se prolongea jusqu’en 1689.
• • • La cathédrale Saint-Antonin et son petit effectif musical actif
En 1787, s’éteint l’évêque Henri-Gaston de Lévis-Léran, né 85 ans plus tôt au château de Léran, situé à une douzaine de kilomètres de Mirepoix. Son épiscopat a duré quarante-cinq années. Joseph-Mathieu d’Agoult (1741-1823) lui succède. Ce dernier, jugé d’un comportement autoritaire et aux manières très aristocratiques, est rapidement rejeté par son clergé qui lui préfère un simple curé comme député aux États-Généraux, puis par les représentants de la noblesse et enfin par ceux du Tiers-État qui refusent également de l’élire. Très hostile à la constitution civile du clergé, il émigre en 1791, mais ne démissionne de son évêché qu’en 1802, au moment de l’application du Concordat.
Le chapitre cathédral a obtenu sa sécularisation en 1745 après des décennies de turbulences. Douze canonicats et autant de semi-prébendes le constituent. À l’intérieur de la cathédrale, après de nombreux raccommodages, le vieil orgue connu depuis le milieu du XVIe siècle est remplacé par celui du monastère bénédictin Notre-Dame-de-La-Daurade, de Toulouse. Grégoire RABINY, facteur toulousain, le restaure et l’installe dans un buffet que nous admirons encore. D’après le devis de 1776, c’est Broquier, un maître menuisier appaméen, qui est chargé des ouvrages de menuiserie. Tout est soigné, y compris la balustrade en fer forgé. Le chantier s’achève en novembre 1777, date à laquelle l’organiste de la cathédrale de Saint-Lizier, François DARGEIN, participe à l’expertise finale.
En 1790, Jean-Baptiste BORDES, d’origine toulousaine, est un organiste jeune et expérimenté. D’ailleurs, à peine arrivé en 1782 d’Auterive, petite ville située sur la route de Toulouse à une trentaine de kilomètres de Pamiers, il est rappelé par ses anciens employeurs pour l’inspection d’un orgue qui vient d’être réparé. De plus, à Pamiers, ses honoraires annuels s’élèvent à 600 livres, acte d’une générosité inaccoutumée de la part du chapitre, lequel lui promet la prochaine prébende disponible. Le serpent Jacques DELMON est au contraire né à Pamiers. Mais il est qualifié de « vétéran du régiment royal » où il a sans doute servi comme musicien. Les chanoines qui louaient « son application au chant » ont soutenu son départ pour une année d’études à l’université de Toulouse. D’après une lettre rédigée en 1791 par l’ancien chapitre, un certain BONNASSIER fut le « dernier » chantre ; il aurait donc remplacé ceux qui ont exercé la charge à mi-temps pendant presque trois décennies : Jacques MERCADIER qui assurait également le secrétariat personnel de l’évêque et Jean-Baptiste CHANAUD parce qui complétait le service de MERCADIER auprès du chapitre. Notons que le second, laïc marié et père de famille, chantre et parfois serpent, participait alors en ville à l’activité récemment arrivée de Toulouse, l’imprimerie. Chapitre et évêque acquittaient chacun une moitié des émoluments de MERCADIER, une source de conflits dont on se souvient parfaitement en 1790, mais qui justifie, aux yeux du district, l’attribution d’une pension à ce dernier protagoniste encore vivant. Cinq noms d’enfants de chœur, Jean Maury, Louis Palmade, Jean Broquier, Vincent Cabibel et Jean-Baptiste Garrigue, apparaissent dans les dossiers de demandes de pension ou de gratification, ce qui surprend, d’abord parce que les groupes précédents semblaient se limiter à quatre, et ensuite parce que aucune des requêtes et délibérations successives ne concerne le groupe complet de ces cinq enfants. François CANCEL, le sonneur de cloches, qualifié de carillonneur sur les registres paroissiaux et le dossier de pension établi au district de Mirepoix, mais qui se disait campanier, apprit le métier dès l’enfance quand il montait avec son père, lui-même sonneur, dans le clocher de la cathédrale. Il assura ensuite sa succession. Et d’après un graffiti que lui-même a sans doute tracé sur un mur du clocher à l’étage du soufflet de l’orgue et daté de 1778, il remplissait également la fonction de souffleur. C’est à Christiane Vanhoutte, actuelle présidente de l’association et carillonneuse à Saint-Antonin, que nous devons cette information ; de plus, elle a bien voulu nous expliquer le travail du sonneur : « se trouvait également à cet étage le "banc du sonneur", siège sur lequel s’asseyait le carillonneur qui maniait quatre cloches, deux aux pieds et deux aux mains. Le banc n’existe plus, mais pédales et poignées sont toujours là, tristement abandonnées ». Après la suppression du chapitre, François CANCEL, qui est marié et père de famille, continue à gagner sa vie comme tisserand et perçoit une pension annuelle de 100 livres.
• • • La collégiale Notre-Dame-du-Camp et son bas chœur mal connu
Cet édifice, né sur des terres marécageuses récemment assainies, puis agrandi au XIVe siècle, accéda au statut d’église paroissiale en 1343 et fut érigé en collégiale sous l’autorité de l’évêque en 1466, tout en demeurant l’église de la paroisse. Ruinée à trois reprises pendant les guerres de religion, elle fut reconstruite grâce à un impôt levé sur les habitants et rendue au culte en 1672. Mais les travaux lourds et délicats que nécessitait le rétablissement de la voûte ne sont entrepris qu’un siècle plus tard. C’est un bâtiment de plan basilical organisé autour d’une longue et large nef unique. L’un des murs, crénelé et flanqué de deux tours aux extrémités, rappelle son ancienne fonction défensive.
Le chapitre se compose d’un doyen, de huit chanoines et de sept semi-prébendés. La présence de deux chapitres dans une petite ville ne pouvait que générer d’inépuisables querelles de préséance. L’abbé Barbier, dans son ouvrage de 1889, explique que les chanoines du Camp sont tenus de contribuer aux principaux offices par la psalmodie et le plain-chant. Néanmoins, on engage des musiciens venus de l’extérieur. Par exemple, en 1772, s’éteint le prêtre Paul Faurie qui, par un don important, a fondé un poste de serpent. Jean MAURY qui « est en état de jouer le plain chant au chœur de la dite église aux messes musicales et fêtes annuelles » est aussitôt engagé par le chapitre. Bien entendu, ce service ne requiert qu’un temps partiel. Aussi, le joueur de serpent mène-t-il de front une activité mal définie de marchand. Ce père de famille dont un garçon est enfant de chœur à la cathédrale en 1790, est issu d’une famille modeste. Voiturier dans sa jeunesse avec son père, puis maître de pension avant son mariage, il devient maître d’école sous la Révolution. Nous ne connaissons pas l’ensemble du bas chœur de 1790. Peut-être que les chanoines l’étoffaient dans les temps liturgiques majeurs. Ainsi Jean-Paul RABOLTE, un laïc marié et père de famille, gagne-t-il sa vie comme cordonnier et cabaretier. Mais ancien enfant de chœur et aussi bien serpent que chantre, il est engagé pour jouer du serpent pendant des durées limitées, notamment en 1781 et 1786. Combien y avait-il de jeunes servants ? Le district de Mirepoix, dans une délibération de la fin décembre 1790, évoque un mémoire qui atteste une dépense pour le raccommodage de six aubes d’enfants de chœur.
Quant aux abbayes et couvents de la ville de Pamiers, le peu de sources disponibles se tait sur leur vie musicale, y compris pour l’église du Carmel où Jacques MERCADIER, chantre de la cathédrale depuis plus de trente-cinq ans, marie sa fille en 1785.
III - TROIS VILLES « MUSICALES » BIEN RÉPARTIES DANS L'ESPACE
Ces trois villes sont les deux autres cités épiscopales et la capitale du comté de Foix.
• • • Mirepoix : seulement trois musiciens et quatre enfants de chœur
Mirepoix, où vivent un peu plus de 3 000 habitants en 1790, est située dans le piémont pyrénéen le plus oriental qui regarde vers la plaine du Lauragais.
C’est en 1317 que le pape Jean XXII, originaire de Cahors et second des papes d’Avignon, érigea l’église prieurale de Mirepoix en cathédrale. Elle était destinée au nouveau diocèse doté de 103 paroisses et succursales. Dans la foulée, naissait un chapitre régulier qui fut ultérieurement sécularisé. Mirepoix était une ville neuve. En effet, une première agglomération de la rive droite de l’Hers avait été emportée par la crue soudaine et très meurtrière de 1289. Sur le bord opposé, on l’avait aussitôt reconstruite en bastide, c’est-à-dire sur le plan des fondations urbaines de cette époque.
Ancienne cathédrale de Mirepoix, l’église Saint-Maurice doit son ampleur, son clocher qui culmine à 60 m. et ses décors à l’évêque Philippe de Lévis, (1497-1537). La nef de style gothique languedocien, c’est-à-dire unique et large, fut encore agrandie lors des travaux de Viollet-le-Duc, ce qui la porta à 21,50 m. (cl. L. Bons, 2020).
En 1790, Mirepoix se serre autour de la grande cathédrale Saint-Maurice élevée en gothique méridional et du palais de l’évêché qui est bâti dans son prolongement. L’ensemble respire la Renaissance car ce fut l’évêque Philippe de Lévis, né au château voisin de Lagarde et sacré en 1497, qui acheva enfin sa construction, l’aménagea, rebâtit le palais et prit l’initiative du clocher octogonal qui monte au-delà de soixante mètres. La grande place garde son air médiéval : elle est entourée par les couverts, ces galeries de bois qui soutiennent d’admirables maisons à colombages, avec poutres et chevrons sculptés. À l’extérieur, le chantier du pont maçonné que l’Anglais Arthur Young admire en 1787, avance : « À Mirepoix, on bâtit un pont magnifique à sept arches plates, […] Voilà douze ans qu’on y travaille ; il en faudra bien deux pour le finir ». En réalité, le chantier se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 1792, sous la surveillance de l’ingénieur Jean-Baptiste Mercadier, fils aîné de l’ancien chantre de la cathédrale de Pamiers. Et le séminaire ? Il est parti, transféré en 1682 à Mazères, petite ville arrosée par l’Hers dans le nord du diocèse, où l’activité du pastel a laissé son empreinte.
François Tristan de Cambon qui occupe le siège épiscopal depuis 1768, est âgé de 74 ans. Dès 1790, il refuse le serment exigé et se retire dans sa famille à Toulouse où il décède l’année suivante. De toute façon, le diocèse de Mirepoix est supprimé au profit de celui de Pamiers.
Selon l’article de l’abbé Eugène Ferran auquel sont empruntées les informations suivantes, le haut chœur se compose alors de douze chanoines dont plusieurs élevés à une dignité et le sacristain qui est en même temps curé de l’unique paroisse. Le bas chœur comprend trente-six membres répartis en prébendiers, hebdomadiers, diacres et clercs. Les dernières ordonnances épiscopales édictées au XVIIIe siècle insistent sur le service choral de chacun. Les chanoines doivent chanter chaque jour, et « les prébendiers [sont] obligés de se rendre au-devant du lutrin, pour y chanter avec les succenteurs » [« sous-chantres » d’après le Dictionnaire de Trévoux]. Il est donc prévu que « les hebdomadiers et prébendiers qui ne savent pas le plain-chant, seront tenus de l’apprendre dans les six mois » et que ceux qui ne sont pas prêtres se rendront au collège de la ville pour s’initier au latin. Il est spécifié que ce service de chant est indispensable, surtout « quand le nombre de chantres n’est pas suffisant ».
Un orgue a été construit avant 1650. Les chanoines ont veillé sur lui. Ainsi ont-ils fait intervenir le facteur lyonnais François Dufayn en 1693, puis en 1739 le sieur Monbrun, facteur de Castelnaudary, avec qui ils se sont entendus sur la somme de 2 000 livres. Mais l’instrument disparaît sous la Révolution.
En 1790, François AGRAMONT, un organiste né et formé en Catalogne, tient l’orgue depuis huit années. Ses séjours dans plusieurs cathédrales espagnoles ainsi que son passage par Toulouse suggèrent un excellent niveau professionnel. Privé de son emploi d’organiste, il finit sa vie comme instituteur en ville, au sein de sa famille. En 1831, lors de son mariage à Mirepoix, le jeune Brustier – qui est le petit-fils d’AGRAMONT –, est dit « organiste », mais sans indication du lieu où il exerce. Sébastien ARNAUD, enfant du diocèse, est arrivé comme chantre à l’aigle de la cathédrale à peu près en même temps qu’AGRAMONT à la tribune. Cependant, il était beaucoup plus jeune, et encore célibataire. Il ne quittera jamais Mirepoix où il fonde une famille, pas plus qu’il n’abandonnera son métier, devenant « chantre de paroisse » comme l’indique le recensement de 1811. Pierre CAVAGNOL, le joueur de serpent, avait obtenu du chapitre un salaire convenable de 500 livres garanti jusqu’à la fin de ses jours. Après 1792, sa pension obtenue, nous ignorons ce qu’il advient de ce musicien.
Quant aux enfants de chœur, ils étaient pensionnaires à la maîtrise, une maison avec jardin située en dehors des anciens remparts. Comment sont-ils formés ? Le maître chargé d’enseigner le chant à ces enfants de chœur n’a pas été identifié : il s’agit probablement de l’un des prébendiers ou des succenteurs. En 1757, l’organiste Jacques BASTRIE devait « montrer la musique et à toucher l’orgue à un des enfants de chœurs qui lui sera désigné successivement par le chapitre ». En 1790, quatre enfants adressent une demande commune au district de Mirepoix qui propose aussitôt 60 livres à chacun. Nous connaissons le devenir de trois d’entre eux. Jean-Baptiste AUTHIER reprendra le commerce de son père. Pierre MARIS, orphelin d’un père tisserand, est jeune ouvrier à l’atelier de son beau-père « tisserand de toile » après 1790. La grande différence entre lui et sa famille élargie, c’est qu’il signe, que son paraphe est soigné et qu’il entame quelques années plus tard une longue carrière d’instituteur. Raimond SIMORRE, lui, intègre l’armée dès 1793, alors qu’il n’est que dans sa dix-septième année. En 1815, quand on le met à la retraite, il est capitaine, chevalier de la Légion d’honneur et ancien d’Austerlitz. L’un de ses fils sera qualifié de « poète chansonnier » à Mirepoix, en 1839.
• • • Saint-Lizier : une riche cathédrale pauvrement documentée
Saint-Lizier ne rassemble qu’un millier d’habitants, mais est le siège épiscopal du diocèse de Couserans depuis les débuts de la christianisation. L’évêché porte le nom de l’un de ses premiers évêques mort en 548 et canonisé sous le nom de saint Lizier. Son buste-reliquaire, une pièce d’orfèvrerie remarquable, sans doute du XVIe siècle, fait partie du trésor de l’église. Bâtie sur une montagne au pied de laquelle coule la rivière du Salat, dans un site magnifique, la petite ville garde les vestiges de l’ancienne cité gallo-romaine. Et, à deux kilomètres plus au sud, le bourg de Saint-Girons poursuit son expansion commencée au Moyen Âge. Frôlant les 3 000 habitants, c’est lui qui est désigné chef-lieu de district en 1790, et sous-préfecture par la suite. À l’ouest, près de la tour du moulin datée du XIIe siècle, un pont aux arches, lui aussi très ancien, franchit le Salat. Les registres paroissiaux évoquent ce lieu à propos des nouveau-nés abandonnés là, « au bout du pont ».
Jusqu’en 1655, l’évêque disposait de « deux églises con-cathédrales », celle de Notre-Dame, ainsi que celle de Saint-Lizier. À cette date, l’évêque Bernard de Marmiesse ne conserva qu’une seule cathédrale, celle de Notre-Dame (dite « de Sède » ou « de la Sède »), accolée à son palais neuf et imposant, et où il réunit les deux chapitres en un seul. Néanmoins, deux paroisses subsistent : la ville haute, épiscopale, grandiose, ouvrant sur un site montagnard immense, et la ville basse à ses pieds, paroissiale autour de l’église romane Saint-Lizier et du très beau cloître « qui n’a pas, dit-on, son pareil dans toute la Gascogne ». C’est évidemment dans cette partie basse que nous pouvons encore admirer l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu. Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Lizier voit maintenant ses principales richesses architecturales inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Au moment de leur première construction, les deux petites églises étaient romanes. Au sommet du site, Notre-Dame s’appuyait sur les fortifications romaines. Agrandie en gothique et considérablement rehaussée au XIVe siècle, les murs de sa nef ont été enrichis de fresques au siècle suivant. Aujourd’hui, dépourvu de toute fonction religieuse, ce brillant édifice est inclus dans le grand Musée Départemental de l’Ariège, installé dans le Palais des Évêques.
En 1789, Dominique de Lastic de Fournels, qui est originaire de Lozère, est à la tête du diocèse depuis vingt années. Il siège aux États-Généraux de Versailles. Mais, totalement opposé aux décisions de l’Assemblée Constituante, il émigre rapidement après la promulgation de la constitution civile du clergé et meurt en Allemagne dès 1795. Il est donc le dernier évêque, bien que le diocèse de Couserans ne disparaisse réellement qu’au moment du Concordat de 1801.
D’après l’abbé Hugues du Tems, dans son Tableau du Clergé de France paru en 1754, le chapitre de Notre-Dame de la Sède est alors « composé d’un archidiacre et de deux précenteurs, deux sacristes, deux ouvriers, d’un aumônier et de douze chanoines ; deux vicaires perpétuels et vingt-quatre prébendés forment le chœur ». Parmi les droits du chapitre, ce dernier rappelle qu’en 1593 il était prescrit que l’évêque devait contribuer par moitié « aux gaiges et entretènement du maître de la musicque, enfans de ceur, chantres, organiste, prédicateur et maistres des escolles ». Qu’en est-il à partir de 1655 ? Les archives de ce diocèse sont très incomplètes, ainsi que les registres paroissiaux de Saint-Lizier.
Notre-Dame-de-la-Sède dispose d’un orgue dont on ne connaît pas le cheminement avant un procès intenté contre l’évêque, autour des années 1720, par Pierre PIQUEMAL, son organiste et maître des enfants de chœur. Au moment de la suppression du chapitre, Guillaume DALMONT est le joueur de serpent. Venu de l’Albigeois, il a fondé une famille à Saint-Lizier, et c’est là que sont nés ses enfants, ce qui ne l’empêche pas d’exercer également à l’abbaye toulousaine de la Daurade pendant un temps. DALMONT ne renoncera jamais à sa profession de musicien : il mourra en 1827 à l’âge de 93 ans dans sa maison de Saint-Lizier, toujours « musicien et pensionné ecclésiastique ». Qui est l’organiste en 1790 ? Un fils DARGEIN, bien entendu. Les DARGEIN forment une grande famille dévouée à l’orgue, et ceci sur plusieurs générations au-delà des limites des pays ariégeois. François, le père, fils d’un chirurgien presque toujours présent aux actes dressés par le notaire apostolique au profit du chapitre, touche l’orgue pendant trente-cinq ans. Il a épousé la fille du maître d’hôtel de l’évêque, lequel a béni leur union. Il s’éteint à Saint-Lizier en 1779. Les Dargein sont très présents dans le monde ecclésiastique de la ville haute, par leur spécificité de musiciens, mais aussi par les mariages des demoiselles avec des notables engagés dans les affaires de l’évêché. Joseph, le plus jeune frère de François, est bénéficier depuis 1765 et prêtre depuis 1768. Pierre, l’un de ses fils, tient l’orgue de l’abbaye bénédictine de Layrac [actuel Lot-et-Garonne] à partir de 1785. Jean-Charles est « apprenti-organiste » en 1785 quand il assiste en témoin à l’établissement d’un testament. Alors âgé de 23 ans en octobre 1791, il réside encore à Saint-Lizier, mais nous ne connaissons pas ses activités du moment. À Notre-Dame-de-la Sède, c’est Joseph-Louis DARGEIN, l’aîné des garçons, qui a pris la suite de son père. Cette période a été troublée par des ennuis financiers. En effet, à cause d’un long conflit né de la succession paternelle, il a fini par voir saisir ses émoluments annuels d’organiste, tout au moins jusqu’en 1787. Mais, comme les dossiers relatifs aux demandes de pension des musiciens manquent, nous ignorons sa situation ultérieure. Les chanoines ont toujours formé des enfants de chœur. D’ailleurs, c’était François DARGEIN qui assurait cette responsabilité en 1761. Et les comptes tenus par le cellérier laissent alors supposer la présence de trois pensionnaires à la maîtrise. En 1790-1791, deux demandes de pension seulement ont laissé des traces. Elles émanent de deux enfants nés à Saint-Girons. L’un d’entre eux, Jean-Pierre-Éloy AROUFE, engagé dans l’armée impériale, sera fait chevalier de la Légion d’honneur à Dresde, en 1813.
L’église paroissiale Saint-Lizier reçoit l’orgue de Notre-Dame-de-la-Sède après la Révolution. Était-elle dotée précédemment d’un tel instrument ? Grill-Maffre, l’auteur de la recherche sur les Orgues d’Ariège, l’a envisagé en observant des indices encore visibles autour du buffet actuel. Mais nous n’avons retrouvé trace d’aucun musicien exerçant en ce lieu en 1790.
• • • Foix : une ville historique qui a perdu ses archives religieuses du XVIIIe siècle
Avec une population évaluée à 3 200 habitants en 1793, Foix est la seconde ville du jeune département. Et, à l’abri du rocher qui porte le célèbre château, l’ancienne capitale du comté promue chef-lieu y occupe une position centrale. Elle était déjà la capitale politique et militaire, tandis que Pamiers, ville de plaine à vingt kilomètres en aval, en était la capitale religieuse et administrative. Le dernier comte fut Henri III, roi de Navarre et comte de Foix-Béarn. Une fois ce dernier comte devenu roi de France sous le nom d’Henri IV, son comté entra, avec ses autres possessions, dans le domaine royal. Au pied de ce rocher, l’abbaye Saint-Volusien et son enclos occupent la pointe que forme la confluence de la rivière Arget avec l’Ariège, à 375 mètres d’altitude. Mais côté sud, les sommets dépassent 1000 mètres et signalent l’entrée dans la montagne avec ses alpages, forêts et minerais. À l’ouest, un col fait passer en direction de Saint-Girons et de la Gascogne. À l’est, une fois l’Ariège franchie et la barrière des plateaux escaladée, la route conduit à Lavelanet, puis se dirige vers la Méditerranée. Foix est bien à un carrefour régional. En revanche, son enclavement naturel l’enferme dans un espace urbain exigu. Aussi l’existence du le pont en pierre qui enjambe l’Ariège détient-il un rôle vital.
• L’abbaye Saint-Volusien apparaît dans les textes au IXe siècle, mais une église préexistait. Charlemagne aurait, en action de grâce, marqué sa victoire de 778 sur les Sarrasins par deux initiatives : la création, tout en haut de la ville, du sanctuaire de Montgauzy et tout en bas, l’érection du premier édifice cultuel en une abbaye bénédictine. La règle de Saint-Augustin y fut introduite au début du XIIe siècle, époque de la reconstruction en style roman. Détruite en 1580 lors des guerres de religion, sa reconstruction ne fut entamée qu’un quart de siècle plus tard. On lui conserva son beau portail roman, ainsi que l’architecture en gothique méridional que lui avait donnée le XIVe siècle.
En 1789, le chapitre se compose de douze chanoines réguliers appartenant à la congrégation de Sainte-Geneviève. Aussitôt après la suppression de 1790, les dix prébendiers expriment, par une supplique qu’ils adressent aux responsables du district de Saint-Girons, leur amertume d’avoir été réduits à l’état de simples frères domestiques : « Le poids du travail pesoit incontestablement sur les seuls prébendés, leur récompense étoit aussi modique, pour ne pas dire infime, [alors que] les revenus des MM les chanoines réguliers étoient considérables, même exorbitants ». Et ils mettent tout leur espoir dans la pension qu’ils attendent.
D’après Jean-Louis Gril-Maffre, un orgue est attesté en 1502. Le chapitre acquittait les honoraires des organistes successifs. Mais pour la fin de notre période, faute d’archives conventuelles, il faut se contenter des registres paroissiaux. Nous n’y avons relevé aucun indice sur la présence d’un organiste. L’orgue avait-il survécu aux destructions des années 1580 et à l’exil des chanoines jusqu’en 1602 ?
En revanche, deux postes, ceux de serpent et de chantre, sont tenus par des musiciens originaires de Pamiers. Paul RABOLTE l’aîné, « infirme » depuis son enfance, musicien et maître d’école dans sa jeunesse, entre au service du chapitre Saint-Volusien aux environs de 1765. Il se marie dans sa ville d’adoption, ses nombreux enfants y voient le jour. Lui, il mène de front la charge de serpent avec une activité de marchand. Sa famille de Mirepoix le rejoint bientôt : sa sœur qui trouve un époux, ses parents, puis Jean-Paul RABOLTE, son plus jeune frère, que les chanoines adoptent comme chantre deux ans seulement avant la Révolution. Avant de saisir cette opportunité bien tardive, cet ancien enfant de chœur de la cathédrale Saint-Antonin gagnait à Pamiers la vie de sa femme et de ses enfants en exerçant divers métiers : cordonnier, cabaretier, serpent par des vacations au chapitre collégial du Camp. Des enfants de chœur servent sans doute à Saint-Volusien en 1790. En effet, dix ans plus tôt, l’un d’entre eux, le petit Joseph LESTEL, fils d’un marchand-tanneur de la ville, est décédé à l’âge de huit ans.
• La chapelle Notre-Dame de Montgauzy, c’est-à-dire de Mont-Joie, s’élève sur les hauteurs qui surplombent la ville. Par l’origine de sa fondation, elle était un prieuré de l’abbaye Saint-Volusien. Au XVIe siècle, avant que la guerre de religion ne fasse rage, une chapelle musicale y est fondée. Jean-Marie Vidal a recherché cette fondation (voir bibliographie), et François Galabert résume ainsi son article paru dans les Annales du Midi de 1939 :
« Jean de Regert, sacriste de Saint-Volusien, puis vicaire général, fonde en 1534 une collégiale de six chapelains et deux enfants de chœur, tous musiciens, chargés de chanter et de célébrer en musique avec orgue diverses messes. Paul III confirme cette fondation en 1546. »
Meurtrie, elle aussi, par le conflit religieux extrêmement violent, la chapelle voit son bâtiment reconstruit au siècle suivant, ce qui lui permet de remplir ses fonctions jusqu’à la Révolution. Mais qui sont alors les musiciens et les enfants de chœur ? Faute d’archives, leurs noms sont, comme en nombreux autres lieux ariégeois, tombés dans l’oubli.
IV - LIEUX DE MUSIQUE DISPERSÉS
D’autres lieux où l’on avait pratiqué longtemps le chant d’Église n’ont pas laissé d’archives sur leurs pratiques cérémonielles du dernier siècle de l’Ancien Régime. L’abbaye des Prémontrés de Combelongue, dans le Couserans, entre dans cette catégorie. D’autres ont été supprimés peu avant la Révolution. C’est le cas de l’abbaye des Bénédictins du Mas d’Azil, lieu de la célèbre grotte préhistorique et d’un conflit aussi long que désastreux avec les protestants. L’un des huit moines était le chantre de la communauté lors du décret épiscopal de fermeture de 1774. Ainsi, les lieux de musique qui entrent dans notre corpus de 1790 sont peu nombreux et se trouvent dans la montagne.
• • • L’Abbaye bénédictine Saint-Antoine et Saint-Pierre, à Lézat-sur-Lèze, est l’exception. Située au nord-ouest, dans la basse Ariège, elle relève du diocèse de Rieux jusqu’à la suppression de ce dernier en 1790. La commune de Lézat, devenue Lézat-sur-Lèze, s’avance en pointe jusqu’à une dizaine de kilomètres seulement de la Garonne et compte plus de 2 000 habitants en 1793. C’est à son abbaye, clunisienne dès le XIe siècle, qui avait jadis étendu son influence sur toute la région, que le bourg de Lézat doit son existence, son développement et sa grande église. Quand commence la Révolution, l’abbaye forme un bel ensemble car on a beaucoup reconstruit au XVIIIe siècle, notamment le logement de l’abbé ainsi que le bâtiment des moines devenu aujourd’hui la mairie de la commune.
Un orgue accompagnait les offices de l’abbatiale depuis le milieu du XVIe siècle. Urbain Gondar, historien-archéologue de Lézat, a retrouvé dans un minutier le contrat de 1540 qui avait été passé « sur la faction des orgues du monastère de Lézat », entre les moines et un facteur d’orgue. La communauté monastique et la famille Batac-Cachac qui vivait au château bâti à cinq cents mètres du village ont tissé des liens privilégiés tout au long des derniers siècles de l’Ancien Régime. En 1738 encore, Jean de Batac se fait ensevelir dans la chapelle Saint-Blaise de l’abbatiale. En 1758, l’un de ses parents, le prêtre Henri François de Cachac, est prébendier de l’abbaye, tandis que son fils Jean-Guillaume Saint-Jean de BATAC y est l’organiste jusqu’en 1769, date de son décès. Mais ce dernier est inhumé dans l’église paroissiale. Serait-ce parce que la petite communauté des moines est troublée par la fin annoncée de l’Ancienne Observance à laquelle ils sont restés fidèles ? Leur dispersion paraît avoir été effective en 1776.
Dès le décès du vieux musicien qui avait vu le jour à Lézat, un jeune organiste nommé François BOULANGER saisit la place vacante. Après avoir quitté sa lointaine province de Champagne, il vient de séjourner auprès de l’orgue de l’abbaye cistercienne de Boulbonne, à Cintegabelle [en Haute-Garonne]. Peut-être se dirige-t-il vers l’abbaye de Bonnefont, mère de Boulbonne et fille de Morimont près de laquelle il est né en 1746. Est-ce l’opportunité d’un emploi qui l’arrête à Lézat, vingt kilomètres plus au sud ? Toujours est-il qu’il y demeure à partir de 1769, épousant une Lézatoise en 1773 et fondant une famille. Au mois de janvier 1793, trois ans après la fermeture de l’abbaye, c’est lui-même qui est nommé commissaire pour venir enlever les archives. Dans son rapport, il insiste beaucoup sur les soins apportés au déménagement de ces neuf siècles d’histoire : « ...que nous avions soigneusement ramassé et emballé dans des saches pour les faire transporter dans la maison de l’administration de Mirepoix ». Mais comme le cartulaire fut, semble-t-il, la seule pièce à être conservée par la suite, nous ignorons tout de l’organisation musicale du chœur qui a précédé la Révolution.
• • • La collégiale Notre-Dame de Massat, dans le diocèse de Couserans, était également l’église de la paroisse du même nom. D’après l’abbé Cau-Durban (voir bibliographie), cette vaste paroisse montagnarde, à faible distance de la frontière avec l’Espagne, totalisait en 1745, avec ses succursales et ses hameaux dispersés, une population évaluée à 12 000 personnes. Comme en de nombreux lieux de la montagne ariégeoise, c’est la production du charbon de bois et la transformation du minerai de fer qui rendaient supportable cette densité surprenante.
La collégiale devait sa fondation au chapitre cathédral de Couserans, à une date lointaine et inconnue. Toutefois, elle dépendait toujours étroitement de celui de Saint-Lizier. Les « sept chanoines de Massat avaient coutume de chanter l’office à haute voix », rappelle l’abbé Cau-Durban. Un accord conclu en 1410 avec le chapitre cathédral avait allégé sensiblement les devoirs. En dehors des jours de service dans les succursales, il est obligatoire pour tous de chanter la messe à la collégiale « alta voce cum notâ ». Et « ceux qui ne connaissent pas le plain-chant sont tenus de le savoir, de Pâques en un an, sous peine d’être privés de pension » D’autre part, les chanoines disposent d’une année « pour reconstruire leur cloître dans lequel ils seront tenus de vivre en commun ». Dans le premier quart du XVIIIe siècle, comme le bâtiment cultuel est devenu trop exigu pour une population en continuelle augmentation, il est reconstruit et agrandi, tout en conservant son grand clocher octogonal. Mais en 1769, l’autorité royale ordonne la suppression de ce chapitre et la réunion de son temporel au chapitre cathédral de Saint-Lizier, lequel est tenu, en échange, de doter quatre succursales d’une église desservie par un prêtre vicaire. Toutefois, en 1790, les chanoines de la collégiale sont toujours réunis à Massat. En effet, à l’issue des vingt années qui suivent la décision royale d’extinction et qui sont ponctuées de procès intentés contre la suppression, rien n’est réglé. De nouveaux chanoines, originaires le plus souvent de la vaste paroisse, ont entretemps reçu de Rome leur lettre apostolique. Cette petite communauté assurait, semble-t-il, la liturgie des services religieux sans recourir à des chantres gagistes.
Dès 1790, les anciens chanoines partent desservir des paroisses environnantes. Le curé Jean Galy-Rochefort, responsable de la paroisse pendant quarante ans et qui avait composé des cantiques en occitan lors d’une épidémie qui sévissait en 1759, continue à officier dans l’église de Massat en tant que « cocuré » jusqu’en 1792. Il est ensuite arrêté et accusé d’être un prêtre réfractaire exerçant un ministère illégal dans la montagne. Emprisonné à Toulouse avec deux autres anciens chanoines de Massat, il meurt en mai 1794.
• • • L’église paroissiale Notre-Dame de Vicdessos, quoique distante de Massat d’à peine trente kilomètres, relève de l’ancien diocèse de Pamiers. Cependant, Vicdessos rappelle Massat par plusieurs points. D’abord, son église dessert une paroisse très étendue puisqu’elle est le bourg principal d’une vallée de Haute-Ariège dont la rivière de même nom se jette dans l’Ariège au niveau de Tarascon. Et d’autre part, la montagne dispose également de forêts et regorge de minerai de fer.
L’église, attestée en 1081 sous le nom de Saint-Martin-de-Sos, dépendait de l’abbaye toulousaine de Saint-Sernin, ce qui explique sans doute que son grand clocher, bien que remanié à plusieurs reprises, rappelle encore celui de l’ancienne abbatiale. Elle fut considérablement agrandie en gothique. Cependant ce sont les XVIe et XVIIe siècles qui ont agréablement marqué son mobilier de petite ville riche. Ainsi, d’après Jean-Louis Grill-Maffre, elle dispose d’un orgue qui remonte peut-être à 1574. Jusqu’au début du XVIIIe siècle, on semble s’être contenté d’un instrument simple, souvent en panne, et d’un exécutant d’assez faible niveau. Mais après la réfection et l’introduction de « toutes les augmentations nécessaires » en 1739 par CARDÉ, un facteur toulousain, ce sont des organistes professionnels qui vont se succéder, et ceci bien au-delà de la Révolution. L’objectif exprimé par la municipalité est alors « d’appeler des chantres au service divin ». Elle acquitte les honoraires de ces musiciens, d’ailleurs bivalents puisqu’ils sont également régents de l’école des garçons. Et les délibérations du Conseil politique sont un réservoir d’informations précises sur les organistes et sur l’entretien de l’instrument.
En 1789, voilà vingt-huit années que Jacques-Urbain ROUAIX est titulaire de cet orgue. Engagé en 1771 sur présentation de « Monsieur Vergniès de la Prade, conseiller du Roy, maire de la présente vallée et avocat en Parlement », le nouveau musicien vient du diocèse de Couserans, plus précisément de Saint-Girons. Il est donc possible qu’il ait été enfant de chœur du chapitre de Saint-Lizier. Trois ans plus tard, toujours sous l’aile protectrice de Vergniès qui s’est chargé d’apporter les procurations paternelles destinées au notaire et au curé, il se marie dans cette ville qu’il ne quittera plus. Toujours fidèle serviteur de l’orgue, il prépare l’un de ses fils qui lui succédera au siècle suivant pour plusieurs décennies.
À l’aube de la Révolution, la chantrerie est placée sous la responsabilité d’Alavau, un prêtre de la Mission. Pierre BUGARD, jeune prêtre de 27 ans, né à Vicdessos et petit-fils du modeste organiste du début du siècle, est le chantre. Nommé vicaire du curé en 1788, il est peu après rémunéré par l’obit réservé à la fonction de chantre. À la fin de l’année suivante, il est promu curé de la petite paroisse voisine de Saleix, qu’il continuera à desservir jusqu’à sa mort. Les deux à trois kilomètres à parcourir ne mettent pas d’obstacle à l’accomplissement de son service de chant à Notre-Dame de Vicdessos. Ce sont plutôt les événements violents qui l’obligent à y renoncer dès la fin l’année 1790.
Dans cette grande église de Vicdessos, des enfants de chœur servent-ils et d’autres voix se joignent-elles à celles de ces prêtres ? Les délibérations municipales ne l’évoquent pas. Mais pourquoi pas ? Ainsi, Vincent CABIBEL, un garçon de la paroisse, est admis à la maîtrise de la cathédrale de Pamiers autour de 1788, soit à l’âge de dix ans. L’organiste Jacques Urbain ROUAIX est, par son mariage, cousin de la mère de Vincent, puis parrain de son frère cadet. Il est difficile d’imaginer que cet enfant de chœur de la cathédrale n’ait pas bénéficié de quelque préparation dans son église paroissiale avant le grand voyage vers la ville de Pamiers. Toujours est-il que l’organiste ROUAIX, soutenu par des édiles exigeants, est un élément actif aux côtés des ecclésiastiques. Et il n’est pas surprenant que l’orgue résiste aux moments difficiles. Ainsi, tandis que le musicien continue à vaquer comme maître d’école et secrétaire des réunions municipales, le curé achète l’instrument lors de la vente des objets mobiliers de l’église Notre-Dame. Complètement restauré en 1986 et 1987, puis classé aux Monuments Historiques, le vieil orgue vit toujours.
• • • L’église paroissiale Saint-Vincent, à Ax, appartient également à l’ancien diocèse de Pamiers jusqu’en 1790. Située en amont de Tarascon, Ax n’est devenu Ax-les-Thermes qu’en 1888. Vu sa localisation extrême, elle fut ville-frontière jusqu’en 1659. La haute montagne la serre de près, tandis que l’Ariège et plusieurs affluents traversent la ville. Grâce aux sources d’eau chaude et sulfurée, connues depuis l’Antiquité et utilisées ensuite par le roi Louis IX pour soigner les Croisés revenus malades, les bains connaissent un essor au XVIIIe siècle, et surtout à partir de 1750.
Cette église est tenue par l’archiprêtre du Sabarthès (une ancienne circonscription d’origine médiévale) et trois vicaires qui ont également la charge de plusieurs paroisses rurales. D’après Jean-Louis Grill-Maffre, cette église disposait déjà d’un orgue en 1595, lequel fut remplacé en 1623. Au cours de sa visite de 1649, l’évêque de Pamiers, François-Étienne de Caulet, le qualifiait « de moyenne grandeur en bon estat ». Dans le registre des délibérations municipales, à la date du 18 février 1802, il est rapporté que l’orgue a disparu, mais sans aucune précision sur la date de cette disparition.
Deux organistes, nommés OLLIVE (ou Olive), nous sont connus dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bernard, aîné de quatre garçons et fils d’un armurier-serrurier de la ville, décède prématurément en 1756 à l’âge de 25 ans. Jean, le second, ne perçoit de la part des consuls que des gages très faibles, soit 50 livres annuelles, et ceci uniquement jusqu’en 1769. Après, le registre des délibérations se tait. Et pour les deux décennies suivantes, aucun nom de musicien ne figure dans les registres paroissiaux. Seuls, sont présents les deux fidèles carillonneurs, Benoît et Guillaume Durandeau. Bernard et Jean Olive étaient-ils frères ? Il est vrai que le frère cadet de Bernard se prénommait Jean, mais des homonymies existaient dans la ville. Une seconde question demeure sans réponse : l’orgue était-il encore à l’honneur au début de la Révolution ?
• • • L’église de Villeneuve-d’Olmes, dans le diocèse de Mirepoix, n’est alors qu’une succursale de la paroisse de Lavelanet, ville principale du Pays d’Olmes et de la vallée du Touyre qui s’en va confluer avec l’Hers aux portes de la cité épiscopale de Mirepoix. Traversé lui-même par cette petite rivière et situé sur un chemin qui conduit au pied de l’ancienne forteresse de Montségur, le petit bourg de Villeneuve marque l’entrée en moyenne montagne. Il ne reste rien de son édifice cultuel qui fut reconstruit au XIXe siècle. Deux chantres sont signalés dans le registre paroissial de 1765, mais par accident : le vicaire des années 1740 omettait de tenir son registre à jour. Après constatation de l’anomalie, le curé de Lavelanet, sous l’autorité de l’évêché de Mirepoix, organise une enquête orale minutieuse afin de retrouver mémoire de ces baptêmes, mariages et sépultures passés sous silence, et de les enregistrer. Les témoins déposent, parmi lesquels ces deux chantres. Il s’agit de François VIVIÉ et d’un autre paroissien nommé Jean BASTIDE. En dehors des services religieux, ils vivent de leur travail d’artisan, le premier comme cloutier et le second comme fabricant de peignes en buis. Nous ne savons rien de leur formation, ni de la qualité de leur plain-chant. Toutefois, les signatures qu’ils apposent ne sont pas si maladroites. Après la sépulture de François VIVIÉ en 1772, à laquelle les assistants nommés sont tous des cloutiers, nous ne relevons pas d’éventuels successeurs dans les registres paroissiaux. Cela prouve sans doute que la mise en lumière de ces deux chantres de paroisse était tout à fait exceptionnelle. Quant à l’église de Lavelanet, aucune source n’y évoque la présence de musiciens.
• • •
L’effectif connu des musiciens d’Église exerçant à la fin de l’Ancien Régime sur les terres du futur département ariégeois est d’une très grande faiblesse. Il se limite à treize organistes, chantres et joueurs de serpent présents dans sept établissements. Neuf d’entre eux sont au service des chapitres des trois villes épiscopales, trois autres exercent dans deux abbayes et un seul subsiste dans une église paroissiale. Il est à noter qu’en dehors de l’orgue, les instruments de musique mentionnés dans les sources se limitent au seul serpent. Les onze enfants de chœur retrouvés sont pensionnaires dans les maisons de maîtrise de chaque cathédrale.
Les salaires annuels de cette génération de musiciens oscillent entre 400 et 500 livres par an : un seul atteint 600 livres, mais plusieurs n’en gagnent que la moitié. Beaucoup de chantres et joueurs de serpent mènent de front une seconde activité rémunérée. Les pensions accordées en 1791-1792, parfois les gratifications uniques pour les anciennetés les plus courtes, réduisent encore ces revenus modestes.
Malgré tout, l’espace ariégeois a accueilli tout au long du XVIIIe siècle des musiciens venus de l’extérieur. Et en 1790, quatre sont concernés ; ils sont originaires respectivement de Catalogne, de la Champagne, d’Albi et de Rodez. Et le flux des sortants, numériquement identique, se retrouve en descendant la vallée de la Garonne jusqu’à Bordeaux. Au moins trois anciens enfants de chœur vont parcourir l’Europe au sein de l’armée impériale et en revenir chevalier de la Légion d’honneur. Quant aux sept autres que nous avons pu suivre, tous ont assuré leur avenir comme artisan, marchand ou instituteur.
Il est regrettable que le corpus soit dans son ensemble aussi pauvre. Certes, l’Ariège, déjà lourdement affaiblie quand s’achèvent, seulement en 1629, les guerres de religion, a perdu une partie de sa mémoire en 1803. Néanmoins, tous les lieux susceptibles d’avoir émis de la musique et des chants liturgiques n’ont certainement pas dit leur dernier mot. Il subsiste forcément des documents dont les découvertes permettront de compléter la connaissance de ce petit monde des musiciens d’Église de l’Ariège.
Renée Bons-Coutant
Programme Muséfrem,
(mai 2020)
Le travail sur les musiciens de ce département a bénéficié des apports notamment de :
Laurent et Laurence Bons, Jean-Pierre Bouyer, Youri Carbonnier, Michèle Coupry, Bernard Dompnier, Sylvie Granger, Isabelle Langlois, Christophe Maillard, Michel Meunier, Françoise Talvard.
Mise en page et en ligne : Sylvie Lonchampt et Agnès Delalondre (CMBV)
>>> Si vous disposez de documents ou d’informations permettant de compléter la connaissance des musiciens anciens de ce département, vous pouvez signaler tout élément intéressant ICI. Nous vous en remercions à l’avance.
L’amélioration permanente de cette base de données bénéficiera à tous.
Lieux de musique connus en 1790 dans le département de l’Ariège
Les lieux de musique sont présentés par diocèse et par catégories : cathédrales, collégiales, abbayes, monastères et couvents, autres établissements et paroisses.
Diocèse de Pamiers
- Cathédrale
- Collégiale
- Abbaye
- Paroisses
Diocèse de Mirepoix
- Cathédrale
- Paroisse
Diocèse de Couserans
- Cathédrale
- Collégiale
Diocèse de Rieux
Pour en savoir plus : indications bibliographiques
SOURCES IMPRIMÉES
- Jean Joseph EXPILLY, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Paris, Desaint et Saillant, 1762-1770, 6 volumes.
- BRUZEN DE LA MARTINIÈRE, Grand Dictionnaire géographique historique et critique, tome premier, Paris, 1739.
- HUGUES DU TEMPS (abbé), Le Clergé de France ou tableau historique et chronologique des archevêques, évêques, abbés …depuis la fondation des Églises jusqu’à nos jours, tome premier, Paris, 1774.
- Jean-Baptiste MERCADIER [fils du chantre François Mercadier], Ébauche d’une description abrégée du département de l’Ariège, imprimée par ordre du citoyen Brun, préfet, Foix, impr. Pamiès, frimaire An IX.
- Arthur YOUNG, Voyages en France (1787-1789), traduction par Henri Sée, éd. A. Colin, 1931.
BIBLIOGRAPHIE
Aucune des villes de l’Ariège n’a retenu l’attention de François LESURE, dans son Dictionnaire musical des villes de province, Paris, Klincksieck, 1999, 367 pages.
- François BABY, Yvette BÉNEZECH-LOUBET et alii, Histoire de Pamiers, Syndicat d’initiatives de Pamiers-Basse-Ariège, 1981, 632 p.
- Philippe BACHET, Orgues en Midi-Pyrénées, tome 1 [Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, ville de Toulouse], Toulouse, Orgues méridionales, 1982.
- Jean BARBIER, L’église et la paroisse de Notre-Dame-du-Camp à Pamiers ; notes historiques, Pamiers, imprimerie Galy, 1889, 110 p.
- Laurent BARRENECHEA (dir.), Occitanie, terre de cathédrales, Montpellier-Toulouse, DRAC Occitanie, 2017, 112 p. (pdf téléchargeable : https://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Occitanie/Files/Doc-Ressources-documentaires/Doc-Publications/Doc-collection-DUO/Terre-de-cathedrales/Occitanie-terre-de-cathedrales.)
- Daniel BERGAMELLI, « Visite éclair aux orgues du Couserans », L’Orgue, 1971, n°137, p. 8-12.
- Xavier BISARO, Chanter toujours, Plain-Chant et religion villageoise de la France Moderne (XVIe-XIXe), Rennes, PUR, 2010, 246 p.
- Louis BLAZY, présente, dans la revue RHEF, 1913, 24, p. 671, l’article de J. DECAP intitulé « Simples notes sur l’instruction primaire dans les paroisses du canton d’Azil avant 1789 », publié dans Bulletin d’histoire du diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix, janvier-août 1913.
- Patrick CABANEL, Claudine PAILHÈS et Philippe DE ROBERT, Le protestantisme en terre d’Ariège, Foix, éd. Conseil général de l’Ariège, 2004, 191 p. et 120 photos.
- Paul DE CASTERA, L’abbaye de Lézat, Nîmes, éd. Lacour-Ollé, 1992, 42 p.
- David CAU-DURBAN, Abbaye du Mas d’Azil – Monographie et cartulaire 817-1774, Foix, 1896, 210 p.
- David CAU-DURBAN, « La collégiale de Massat en Couserans », Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, 1899-1901, p. 195-199.
- David CAU-DURBAN, Le clergé du diocèse du Couserans pendant la Révolution, Toulouse, Privat, 1903, 72 p.
- Michel DETRAZ, « Des guerres de religion à la Révolution (1550-1789) », Histoire de Pamiers, éd. Syndicat d’Initiative de Pamiers - Basse-Ariège, 1981, p. 233-321.
- Michel DETRAZ, « Le Carmel de Pamiers », Bulletin de la Société ariégeoise, 1991, t. 46, p. 127-158.
- Jacques DUBOURG, Les abbayes de Midi-Pyrénées, St-Cyr-sur-Loire, éd. Alan Sutton-Passé Simple, 2009, 192 p.
- Clémence-Paul DUPRA, « Les travaux de Philippe de Lévis, évêque de Mirepoix (1497-1537) », Bulletin Monumental, année 1937, 96-4, p. 409-423.
- Gilles DUSSERT, Vadier, le grand inquisiteur (1736-1828), Paris, Imprimerie Nationale, 1989, 274 p.
- Eugène FERRAN (abbé), « Le chapitre cathédral de Mirepoix (1318-1790). Ses institutions, ses revenus et ses charges », Bulletin de la Société Ariégeoise, 1901-1902, p. 237-263.
- François GADRAT, « Le mouvement de la population en Ariège de l’An IX à 1936 », Revue géographique des Pyrénées et du sud-Ouest européen, année 1938, 9-1, p. 5-45.
- Éric GÉRAUD, Dictionnaire des Francs-Maçons ariégeois, Nîmes, éd. Lacour-Ollé, 2004, 183 p.
- Maurice HYGONET, Éric GÉRAUD, Histoire des Francs-Maçons ariégeois, Nîmes, éd. Lacour-Ollé, 2004, 454 p.
- Jean-Louis GRILL-MAFFRE, « Orgues d’Ariège », Bulletin de la Société Ariégeoise, 1975, tome 30, 1975, p. 129-218.
- Florence GUILLOT, « L’abbaye bénédictine du Mas d’Azil (Ariège) et son contexte à travers la documentation écrite de ses origines au XIVe siècle », Revue du Comminges, 2006, p. 31-50.
- Georges JORRÉ, « L’industrie dans les Pyrénées de l’Ariège », Revue géographique des Pyrénées et du sud-Ouest européen, année 1938, 9-1, p. 110-129.
- Stéphane LAFUENTE, Miglos, une baronnie du Haut-comté de Foix sous l’Ancien Régime (1599-1789), Mémoire de maîtrise, Université Toulouse-Le Mirail, 1995, 234 p.
- Claudine PAILHÈS, La vie en Ariège au XIXe siècle, Pau, éd. Cairn, coll. La vie au quotidien, 2008, 347 p.
- Claudine PAILHÈS, Images de la Révolution Française en Ariège, Foix, éd. Conseil Général Ariège : Archives départementales, 1989, 127 p.
- Claudine PAILHÈS, Foix et ses environs, Tours, éd. Alan Sutton, 2001, 198 p.
- Claudine PAILHÈS, Mirepoix et ses environs, Tours, éd. Alan Sutton, 2001, 128 p.
- Isabelle PEBAY-CLOTTES, « Réparation et reconstruction d’églises dans le diocèse de Pamiers au début du XVIIe siècle », Revue d’Histoire de l’Église de France, 1987, 190, p. 26-29.
- Henri ROUZAUD, Histoire d’une mine aux mineurs. La mine de Rancié (comté de Foix) depuis le Moyen Age jusqu’à La Révolution, Toulouse, Privat, 1909, 114 p.
- Michel SÉBASTIEN, « Une ville de vallée », Histoire de Pamiers, Syndicat d’Initiatives de Pamiers-Basse-Ariège, p. 9-13.
- François TAILLEFER, « Aux origines de Pamiers et de Mirepoix : un accident fluvial », compte-rendu par l’auteur dans Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1984, 55-4, p. 540.
- Jean-Marie VIDAL, « Notre-Dame de Montgauzy à Foix à propos d’une chapelle qui y fut fondée au XVIe siècle », Bulletin Historique du diocèse de Pamiers, 1937-1938, p. 49-69.
Bibliographie élaborée par Renée BONS-COUTANT
(mai 2020)